La ''sapologie'': quand être est synonyme du paraître
La ''sapologie'' :
Quand être est synonyme du paraître[1]
Christian Mukadi, SJ
(Abstract) La sape est une pratique qui paraît banale pour la plupart d’observateurs des sociétés congolaises (Kinshasa et Brazzaville). Devant une telle attitude, cette réflexion cherche à indiquer que la sape peut être comprise comme un art de la valorisation de l’extérieur ou un culte du paraître, une religion qui confirme ses adeptes dans leur être. En ce sens, elle a un poids ontologique. Parce que, somme toute la sape constitue véritablement une vision du monde, mieux une philosophie.
Introduction
Il est une pratique très répandue au Congo Kinshasa et au Congo Brazzaville : la sapologie. Celle-ci est liée à l’idéologie qu’incarne le phénomène sape. L’engouement qu’il crée et son impact sur la société suscitent en nous l’étonnement, mieux, nous incite à un questionnement de fond, car ce fait de société, apparemment banal, se veutune philosophie, une vision du monde. Au-delà des discours populaires qui se tiennent sur le phénomène sape, comment, peut-on approcher cette pratique qui semble mettre un accent particulier sur le paraître que sur l’être ? C'est dire quelle lecture métaphysique et phénoménologique pouvons-nous faire de la sape? Notre démarche s'articulera en deux axes. Dans un premier temps nous tacherons de faire simplement un travail d'histoire de la sape. Celle-ci nous permettre de situer notre discours métaphysico-phénoménologique de la sape. Ceci constituera le deuxième versant de notre démarche qui es une philosophie du quotidien, mieux de la banalité.
1. Aux origines de la sape
Lasapologie est un néologisme issu du milieu des jeunes de Brazzaville (Potopoto) et de Kinshasa. Il vient du mot SAPE: Société des Ambianceurs et des Personnes Elégantes. De sapedérive le verbe « saper », qui signifie être bien habillé. La sapeest constituée d’organisations, mieux des clubs d’amis dont les membres s’appellent sapeurs : « hommes qui se soucient de leur élégance et qui s’habillent à la dernière mode.»[2]En effet, la charge sémantique que porte le mot sapeurest une invention typiquement africaine, et spécialement congolaise (Kinshasa et Brazzaville). D’après Papa WEMBA, un des Seigneurs de la sape, « le concept sape ou Kitendi, est une forme de religion de l’habillement qui prône l’élégance prestigieuse et de dernière mode ainsi que la propreté ».[3]
Lasapeest un mouvement qui compte beaucoup d’adeptes, majoritairement jeunes, dans les milieux urbains et populaires de Kinshasa, de Brazzaville et en Europe, principalement à Paris. Pour J-D Gandoulou, la sapeest, pour les jeunes, le symbole de l’Occident véhiculé par la classe sociale de ceux qui se retrouvent.[4]Ainsi, tout dans la sapese situe au niveau des apparences. L’essentiel est de « capter les signes extérieurs de la réussite, de les répercuter pour sa propre satisfaction et pour l’approbation et le renforcement du groupe de référence».[5]D’où le hiatus entre, d’un côté, le sapeurvedette qui s’habille à la dernière mode, c’est-à-dire qui met les meilleures ‘’griffes’’ :JM Weston, Giani Versce, Valentino, Giogio-Armani, Yves Saint-Laurent, Kansaï-Yamamoto, Yoshi Yamamoto, etc. ; et, de l’autre côté, les conditions de vie bien souvent précaires dans lesquelles ce même sapeur vit.
En outre, il se révèle que l’aspiration fondamentale d’un sapeurest de franchir les frontières de Mikili (l’Occident), et spécialement de Paris qui est le « royaume du kitendi. » A en croire Manda Tchebwa, dans la mythologie de lasape, Paris peut être considérée comme la ‘’Mecque’’ des sapeurs.[6]Il faut donc y effecteur un ‘’pèlerinage’’ pour être un ‘’sapeur accompli ‘’. En plus, en ce qui concerne l’appréciation de la sape, le meilleur sapeurest celui qui s’habille de manière intégrale, i.e. à griffe quadridimensionnelle : griffe teint, c’est-à-dire la couleur de la peau : jaune papaye[7] ;griffe balcon, c’est-à-dire la coiffure : punk, rockers, skinheads,..;griffe rez-de-chaussée, c’est-à-dire la chaussure : Weston, Boston, Giovanni; griffe morphologie : pour êtresapeur, il faut avoir une morphologie qui reflète une certaine aisance matérielle et physique. Pour être considéré comme un adepte orthodoxe de la sape, il est nécessaire de réunir les quatre critères. Les quatre dimensions précitées constituent les critères d’évaluation de l’orthodoxie de la sape.
Si l’on reconnaît à l’Afrique centrale en général et aux Congo Brazzaville et Congo Kinshasa, en particulier, la paternité de la sape, il est difficile de dater son début. Toutefois, la tendance dominante s’accorde à situer la naissance du phénomène sapeautour des années 1950-1960. C’est vers ces années qu’ont émergé – en marge de la montée en puissance de la musique congolaise moderne : la rumba – des associations qui se reconnaissaient comme des clubs d’amis ‘’ambianceurs’’ en RD. Congo. L’ambiance est à prendre dans son acception africaine : le culte du divertissement, de la joie, de l’amusement, du sexe, etc. Il en va sans dire qu’ici l’ambiance va de pair avec la musique. Et ce sont donc dans les espaces consacrés à la musique congolaise moderne, les bars, qui ont servi de premiers creusets de la sape. Il y avait des bars mythiques qui constituaient des véritables centres d’attraction des ambianceurs. C’est le cas de Congo Bar, Amuzu, Kuiste, Mayandila, Vis-à-vis, Yaka Awa, Zeka Bar, etc. Les bars constituaient des véritables temples de divertissement et de loisir dans une Kin-la-belleoù c’est « la joie, toujours la joie ».[8]Il y a eu donc autour du temple de la musique congolaise moderne, des associations d’élégance et d’agrément où des jeunes se retrouvaient pour nulle autre raison que le loisir. Le loisir est à saisir ici comme « une occasion de défoulement. Un moyen de parvenir à un ailleurs absolu mais toujours éloigné. »[9] C’est là que se situe la naissance des Muziki :associations, souvent inter-ethniques, d’entraide et de soutien, au sein desquelles les membres se cotisaient pour passer ensemble des moments de joie, de divertissement et d’amusement. C’est le cas de la Florette, Bana la joie, Club de 7, BanaAmida, Bana Agès, etc.
En outre, il y a eu aussi des concours de beauté, de miss, de danse et des concours d’orchestres de Kinshasa. Ces compétitions, qui se tenaient au jardin botanique de Kinshasa, ont également contribué à l’éclosion de l’avènement de la sape. Toutefois, c’est davantage le concours de beauté qui a le plus influencé l’émergence de la sape. En plus, ces évènements se déroulaient dans un contexte où la ville de Kinshasa s’urbanisait. Ainsi, l’idéal consistait à imiter le blanc ; les ‘’évolués’’ veulent manger, s’habiller, parler, marcher, boire, etc. comme le blanc. C’est également à cette époque que les sociétés hollandaises vont répandre le pagne (Wax hollandais), venu de la « route de la soie » : Indonésie et Java. Les associations des ambianceursévoluent jusqu’à la rupture imposée par le recours à l’authenticité sous le règne du président MOBUTU vers les années 1970.
Avec le recours à l’authenticité[10]décrété par MOBUTU le 27 octobre 1971, il y a une politisation et une standardisation du vêtement. L’on décrète l’abacost (à bas le costume) et foulard au coup, pour les hommes, et le pagne pour les femmes comme habille officiel du Zaïre. En plus, tou(te)s les Zaïrois(e)s s’habillent de la même façon. Cette manière de concevoir l’habillement est aussi une forme de sape ; parce qu’avec « MOBUTU, c’est l’esthétique du pouvoir, la cosmétique du pouvoir comprise comme effets extérieurs du pouvoir »[11]qu’il faut présenter avec pompe. Il s’agit d’une valorisation de l’extérieur. Et d’aucuns ne cessent de souligner le fait que MOBUTU était un grand amoureux de l’art. A l’époque de la zaïrianisation, l’habillement est non seulement un facteur d’uniformisation, à l’intérieur du pays, mais aussi un trait distinctif ou de différenciation de tout ressortissant Zaïrois à l’extérieur du pays. Partout à travers le monde l’on reconnaissait le (a) Zaïrois (e) par l’abacost, pour les hommes et le pagne pour les femmes. Ceci jusqu’aux débuts des années 1980.
Alors que la première rupture était idéologique et politique, la deuxième est survenue grâce à des nouvelles générations montantes dans le domaine musical avec des orchestres tels que Tu zaïna, Zaïko, Zembe Zembe, Viva la musika, etc. Cette nouvelle génération a opéré, non seulement une rupture de rythme dans la rumba congolaise, mais aussi une rupture de fond, en rendant l’ambiance jeune et anticonformiste, avec la montée de atalaku (animateur). Ce n’est plus la musique romantique et respectueuse des normes classiques qui importe, mais la danse et les cris. Il y a plus des mouvements que de contenu. L’on va tout doucement de la valorisation du contenu, à celle du contenant. C’est de là qu’est partie la sapeavec comme tête d’affiche Papa WEMBA ; parce qu’il fallait une ténue qui attire les spectateurs. En plus, avec l’évolution de la tenue des artistes, la tenue de scène est devenue tenue de ville. Ainsi, cette nouvelle génération d’artistes musiciens a réinventé la scénographie vestimentaire. En outre, l’avènement du show musical, c’est-à-dire la démonstration sur scène, a mis en avant le show vestimentaire : la démonstration vestimentaire afin de démontrer que l’on porte une griffe ‘’dernier cris’’ ; de très haute facture. C’est de là qu’est partie la ‘’déviation’’, d’après A. YOKA ; parce qu’il y a eu une forme de concurrence sur la valeur extérieure. Et la valeur était liée à la griffe ; l’on s’habille selon les bons couturiers : Mazamtomo, Louis Vuitton, Gucci, Courrège, etc.[12]
Au fur et à mesure que les années passent, le mouvement s’est détaché du domaine de la musique pour devenir un mouvement autonome avec des figures telles que Stervos Ngatshe Niarkoset Papa Wemba. Il s’est alors formé en Europe un réseau qui s’est nommé religion du kitendi ou du lele (tissu ou matière en lingala). Il s’agit d’une religion dans la mesure où il y a tous les caractéristiques de cette dernière : un culte, une doctrine, des idoles, des temples, une forme de liturgie, un grand prêtre, etc. Ce culte transparaît bien souvent lors de cérémonies comme les anniversaires, en l’occurrence celui de NIARKOS le 10 février, lemariage ou le décès d’une star, le 40èm jour après la mort d’un proche... A l’occasion des tels évènements, il y a des célébrations publiques pour exhiber les costumes les plus ‘’extravagants’’.
Après ce bref aperçu historique, il serait opportun de faire une approche philosophique de la sape. Celle-cinous permettra de ne pas nous limiter au simple discours que porte l’homme de la rue sur ce phénomène, et de saisir la dynamique qui se déploie derrière ce fait banale de la société. Mieux, au-delà de ce qui peut apparaître comme simple discours de l’extériorité ou du paraître, peut-on y ressortir une phénoménologie ?
 |
| Démonstration des quelques sapeurs en milieu parisien |
2. Je m'habille donc je suis : une approche philosophique de la sape
A en croire le professeur A. YOKA, il y a deux approches possibles du phénomène sape ou sapologie. La première considère lasapologiecomme un culte hédoniste, c’est-à-dire un culte de la joie et de la jouissance. Cette approche considère la sapecomme un simple club de jouisseurs. La deuxième considère ce même phénomène comme « un culte du paraître et de l’exhibitionnisme. Ainsi au lieu d’être, le sapeur, paraîtpar les masques de l’extérieur : le ténue vestimentaire et le langage, etc. »[13]Il s’agit d’un culte du paraître à travers une manière recherchée de s’habiller, de parler et même de marcher ; ceci en vue de la séduction. Alors que la première approche de la sapeest soutenue, en majeur partie, par le monde occidental, la deuxième approche a plus d’audience dans les arcanes des intellectuels africains, en l’occurrence, A. YOKA.
En dehors de ces deux approches, il apparaît en filigrane une troisième approche, celle d’Alain Mabanckou. Pour ce membre du collège de France,
« Si d’aucuns perçoivent la sapecomme un simple mouvement de jeunes (…) qui s’habillent avec un luxe ostentatoire, il n’en reste pas moins qu’elle va au-delà d’une extravagance gratuite. Elle est, d’après les sapeurs, une esthétique corporelle, une autre manière de concevoir le monde – et, dans une certaine mesure, une revendication sociale d’une jeunesse en quête de repères. Le corps devient alors l’expression d’un art de vivre. »[14]
Le point de vue d’A. Mabanckou dénote le fait que la sapeest véritablement une philosophie, une vision du monde : une esthétique corporelle et une quête identitaire.
Partant de ces trois approches de la sape,quelle appréhension pouvons-nous faire de la sape ? Pour nous, la sapese veut comme un art de la valorisation de l’extérieurou un culte du paraître, comme unereligionet une vision du monde.
3. a. La sapecomme culte du paraître
Avec la rupture artistique des années 1970-1980, la nouvelle génération des musiciens ont transformé l’art en des formes rituelles qui s’inscrivent dans un mimétisme vestimentaire ostentatoire propre aux sociétés de consommation.[15]Il s’agit d’une génération qui a mis un accent particulier sur la créativité vestimentaire et sur la séduction. Ainsi, c’est le règne l’habillement excentrique où la griffe la plus chère constitue le critère de la valeur qu’incarne un individu. Avec la sape,nous sommes au creuset d’une idéologie de la valorisation du paraître avec comme tête d’affiche Jules Shungu Wembadio, Jo Ballaerd, Stevos Niarkos. Ces figures sont considérées comme des Seigneurs de la sape. C’est eux qui ‘’fixaient’’ le code vestimentaire dans les grandes maisons de couture à travers le monde.
Dans l’arène de la sape, en effet, être c’est paraître. Ainsi, nous sommes là au cœur d’un renversement de la notion classique de l’ontologie qui est marquée par la primauté de l’être. L’on passe de la primauté de l’êtreà celle du paraître. Etre c’est paraître, c’est-à-dire il faut paraître pour se sentir confirmer dans son être. Plus l’on paraît, mieux, plus l’on porte des griffes de haute facture, plus l’on se sent confirmé dans son être. Il ne s’agit pas de n’importe quel paraître, mais d’un paraître élégant, bien coiffé, bien habillé, bien chaussé et bien parfumé ; et cela à tout prix ! C’est ainsi qu’un adepte de la sapepeut accepter de manquer du pain, mais non une chaussure Weston, ou une veste Lewisquatre pièces qui vient de paraître.
L’idéologie de la sapese manifeste de manière inouïe lors des différents évènements de la société. En de telles circonstances, l’on cherche à s’habiller de façon excentrique pour des simples raisons de démonstration et de séduction. Ainsi, feindre un semblant de prospérité : avoir le costume le plus griffé, la chaussure de la grande marque, la voiture « dernier cris », etc. Ce souci de paraître a atteint presque toutes les couches de la société. Nous n’avons pas seulement des stars ou des vedettes sapeurs, mais aussi des députés sapeurs, des ministres sapeurs, des pasteurs sapeurs, des prêtres sapeurs, des religieux sapeurs, etc.
3. b. La sapecomme religion
| La Société des Ambianceurset des Personnes Elégantes s’érige en une véritable religion : religion du kitendi : (religion du tissu). La saperéunit de faits les conditions classiques requises pour parler d’une religion[16] : (1) un système de croyances ou de doctrines qui met les croyants en relation avec le sens ultimede la vie. Dans le monde de la sape, le sens de la vie est déterminé par le paraître élégant : la vie n’a pas de sens si l’on ne met pas des coutures ou des chaussures de haute facture ; (2) une pratique religieuse, des commandements qui tracent la limite entre ce qui est permis et ce qui ne l’est pas (l’interdit) : lasapea la manière de procéder à l’instar de celle de certains mouvements initiatiques. Elle a ses exigences qui mobilisent et focalisent toutes les énergies, les valeurs, et en règle sa meilleurs pratique.[17](3) une communauté identifiable : la sapeelle-même constitue une communauté au Congo Brazzaville comme au Congo Kinshasa ainsi que dans les grandes villes occidentales où vivent les communautés de sapeurs de la diaspora. |
En outre, lorsque l’on prend en considération l’approche de la religion africaine faite par John MBITI, l’on peut admettre que la sapeest une religion au sens africain du terme. En effet, pour l’auteur précité, la religion africaine est fondée sur des rituels et des cérémonies ; des places et des objets sacrés ; l’art et les symboles ; la musique et la danse ; les proverbes etc. Bref, sur tous les aspects de la vie.[18]Et lorsque nous approchons la sape, l’on observe qu’elle a son culte, ses idoles, ses grands prêtres, sa liturgie, des commandements, ses lieu de culte, etc. L’on est là devant une religion dont la dimension transcendantale se manifeste par les cultes que les membres de la saperendent à leurs Seigneurs.
 |
| Papa Wemba dans une maison d'habillement à Paris |
3. c. La sapecomme vision du monde : esthétique et quête identitaire
Pour une meilleure appréhension esthétique de la sape,il ne faut pas chercher les critères dans les canaux classiques d’esthétique corporelle. En plus dans la sape, il ne s’agit pas d’une esthétique qui se fonde sur un hédonisme béant, mais sur une symbolique profonde à l’instar de tout art africain : signe et signification du divin, de la beautéet de la vérité.[19]En effet, à en croire E. MVENG, le caractère symbolique de l’art nègre est toujours et déjà une « expression du drame de la vie caractérisé par la lutte gigantesque dans laquelle la vieet la mortaffrontées constituent le fondement dialectique de l’existence. Mais cette lutte n’est qu’un prélude ; parce qu’elle précède la victoire de la viesur la mort. »[20]En ce qui concerne la sape, la mort est comprise comme la carence, le manque d’habit de luxe, de griffes les plus chères que produisent les maisons de haute couture. Ainsi la vie, c’est le contraire : l’apparence et l’élégance. Dans cette perspective, l’on peut mieux saisir la pointe de Jo Kester Emeneya lorsqu’il affirme qu’« un musicien sans griffe est un Taureau, c’est-à-dire un condamné à mort. »[21]Pris sous cet angle, l’habillement et l’élégance, à travers les masques extérieurs ne sont plus à considérer comme une esthétique pour l’esthétique, mais comme une médiation cosmique qui vient combler l’incomplétude d’un être qui se sent toujours et déjà insuffisant et cherche à être confirmé dans son être. C’est ce qu’affirme E. MVENG :
« La fonction du vêtement est de donner à la nature de devenir le prolongement du corps humain, de l’associer au destin de l’homme, de l’humaniser […] La coiffure, les colliers, les sandales, sont de véritables livres écrits qui célèbrent, sur le corps humain, la victoire de la vie sur la mort. »[22]
Cette approche opère ce que nous avons nommé plus-haut : renversementde la notion classique de l’ontologie qui est marquée par la primauté de l’être.La valeur de l’êtreest déterminée par le prestige et la renommée que l’on reçoit des autres à partir de la manière dont on apparaît. Ainsi, la sapedevient une quête identititaire. Chaque sapeur cherche à être confirmé par son idole, afin d’obtenir la ‘’licence’’ et d’entrer ensuite dans le cercle des sapeurs accomplis. Avec cette nouvelle identité, le sapeurse sent pleinement homme parce que son nom est marqué dans les annales de la sape.
Conclusion
Au-delà des discours qui se tiennent sur ce fait de société ( la sape) quelle appréhension philosophique peut-on faire ? Voilà la question qui a constitué la trame de fond de notre travail. Nous avons articulé notre réflexion en trois points. Nous avons commencé d’abord par nous demander c’est quoi la sape ?Nous avions mentionné que la sape est un néologisme qui désigne la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Ensuite, nous avons fait un aperçu historique de la sape, en soulignant le fait qu’elle a pour berceau les deux Congo : Kinshasa et Brazzaville, et que son émergence est à celle de la musique congolaise moderne. En outre, nous avons signalé que l’histoire de la sape est marquée par deux ruptures : d’abord, en 1970, avec l’idéologie du recours à l’authenticité, puis vers les années 1980 avec la montée de la rumba moderne. Enfin, nous nous sommes attelés sur une approche philosophique de la sape. Nous avons montré qu’il y avait trois approches possibles : la sapecomme simpleculte hédoniste, la sape comme culte du paraître et de l’exhibitionnismeet la sape commeune vision du monde : une esthétique corporelle et une quête identitaire.Les trois approches nous ont permis de comprendre la sape comme un art de la valorisation de l’extérieurou un culte du paraître, comme unereligionet comme unevision du monde : une philosophie. En outre, à la suite d’Engelbert Mveng, nous avons souligné que la sapeest véritablement l’expression de la symbolique de la lutte entre la vie et la mort, comme tout art nègre, une lutte qui se solde toujours par la victoire de la vie sur la mort.[23]
[1]Faute d’une littérature élaborée sur la question de la Sape, nous avons procédé, en grand partie, par les interviews. Sur ce, nous sommes très reconnaissant à l’égard du professeur André YOKA pour l’entretien si éclairant qu’il nous a accordé sur ce phénomène sociétal.
[3]MANDA TCHEBWA, La terre de la chanson, la musique zaïroise hier et aujourd’hui, Ed. Duculot, Louvain-la-Neuve, 1996.p. 194.
[4]MANDA TCHEBWA, Op. Cit,p. 194.
[5]MANDA TCHEBWA, Op. Cit,p. 194.
[7]La préférence de la couleur jaune papayedénote un complexe d’infériorité raciale du Noir devant le Blanc.
[8]MANDA TCHEBWA, La terre de la chanson, la musique zaïroise hier et aujourd’hui, p. 143.
[9]Ibid. p. 145.
[10]Il s’agit d’une idéologie, promue par le président Mobutu, selon laquelle tout doit être puisé dans le patrimoine culturel zaïrois. Il fallait donc renoncer à tout ce qui avait une connotation étrangère. La veste et la cravate sont remplacées par l’abacost (abat le costume). Les croix sont enlevées des salles de classe et sur les places publiques ; les prénoms chrétiens supprimés dans le registre de l’état-civil. Joseph-Désiré, cède la place à Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga. Ainsi, tous les Zaïrois devraient suivre l’exemple du « Guide suprême » et bannir les prénoms à consonance étrangère.
[16]F. FLINN, scientologie : les caractéristiques d’une religion, Ed. Freedom publishing, 1994, USA, p. 1.
[19]E. MVENG, L’art d’Afrique noire,Ed. Mame, Paris 1964, pp. 51-52.
[20]E. MVENG, Structure symbolique de l’art négro-africain, in Présence Africaine, N° 49 – 1erTrimestre 1964, p. 116.
[21]MA MANDA TCHEBWA, Op. Cit.p. 201.
[22]E. MVENG, Art nègre art, art Chrétien? Ed. Les amis Italiens de Présence Africaine, Rome, 1967, p. 22.


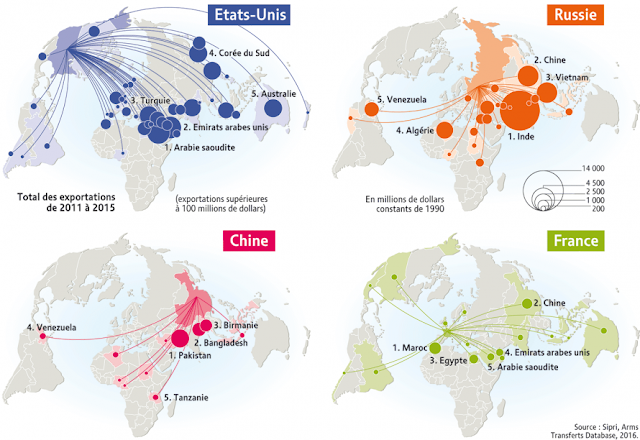
Commentaires
Enregistrer un commentaire