Le contrôle par le peuple comme enjeu d'une culture démocratique en RD Congo : De l’anaxocratie à la démocratie
Le contrôle par le peuple comme enjeu d'une culture démocratique en RD Congo :
De l’anaxocratie à la démocratie
Par Christian Mukadi
Dans les lignes qui suivent nous proposons une approche de la démocratie comme contrôle par le peuple. Ceci va sans dire que le contexte sociopolitique de la RD Congo, nous oblige non seulement d’êtres réticents envers une conception simpliste de la démocratie : pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple(Abraham Lincoln) ; mais aussi de (re)penser cette dernière. Nous articulons notre réflexion en trois axes. Dans un premier temps nous allons ébaucher les fondamentaux de la démocratie en partant de l'approche que propose Robert Dahl. Ensuite, nous soulignerons le fait que la gestion de la res publicaen RD Congo échappe fondamentalement au contrôle du peuple. Face à cette réalité nous mettrons, enfin, en évidence la notion de contrôle par le peuple comme enjeu d'une culture démocratique.
1. Les fondamentaux de la démocratie
Parler des fondamentaux de la démocratie c'est faire mention des critères qui font qu'une
gestion soit qualifiée de démocratique. Nous pensons que R. Dahl est l'un des auteurs qui disent mieux au sujet des fondamentaux de la démocratie. Pour ce politologue américain, est démocratique toute gestion qui obéit au filtre de cinq éléments que sont : la participation réelle
du peuple ; l'égalité de vote ; une information assurant une parfaite compréhension des enjeux, le contrôle de l’ordre du jour et l’inclusion de tous les citoyens majeurs (R. Dahl, 2000). La trame de fond de ces critères est le fait que toutes les décisions qui touchent à la gestion de la communauté doivent non seulement émaner du peuple ; mais aussi répondre à leurs aspirations.
Cependant, parce qu'il n'est pas aisé que tout le peuple se réunisse de manière pérennante pour discuter sur les sujets qui touchent à la chose publique, ce même peuple se choisit des représentants (démocratie représentative). Ce choix constitue un contrat à durée déterminée (alternance démocratique) qui en substance oblige, d’une part ceux qui ont reçu mandat de représenter le peuple de rendre compte— sans aucune autre forme de procès— à ce dernier (le souverain primaire). D’autre part, il oblige les mandants d’exiger les comptes à leurs mandataires. Cependant, pour que ce contrat demeure effectif, il faut que le peuple ait une mainmise sur ses représentants ; (de quelle manière ?)
2. En RD Congo la démocratie est à venir
L'on reproche généralement à la démocratie représentative en Afrique deux faiblesses : La tyrannie de la majorité, c'est-à-dire que la voix de la minorité n'est pas prise en considération ; et la crise de représentation : une fois élus, ceux qui étaient censés être les représentants du peuple ne défendent pas les intérêts de ces derniers ; mais ceux de leurs familles politiques et de leurs autorités morales. Devant une telle situation, la définition étymologique de la δημοκρατία(démocratie) : pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuples'avère utopique et inopérante. Parce que le peuple est dépossédé de tout son pouvoir. Et par ricochet, ne contrôle ni ne gère guère la chose publique. Dans ce cas il serait alors honnête de parler de l’anaxocratie qui serait alors comprise comme pouvoir du chef par le chef et pour le chef.
La crise que traverse la RDC est en partie due au fait que le peuple n’est plus souverain primaire, mieux n’est pas le souverain primaire. En effet, il est difficile de ne pas admettre que la RD Congo est dirigée par un club d’amis qui lutte pour maintenir au pouvoir coûte que coûte (Déclaration de la CENCO du 23 Juin 2017). Devant ce fait, nous refusons de nous contenter d’une définition scolaire de la démocratie ; parce que celle-ci fait du Congolais, à la fois, actrice et victime d'une escroquerie politique active et passive. C’est-à-dire une situation où le peuple a confié le pouvoir entre les mains des représentants qu’il ne sait plus contrôler suite à la malice de ces derniers et à sa passivité propre. Il est ainsi nécessaire de mettre un accent particulier sur ce que nous paraît comme fondamental en démocratie pour l’avènement d’un véritable système démocratique en RD Congo : le contrôle par le peuple. La situation est telle que le peuple n'a plus, par l’entremise de ses délégués, une mainmise ni sur le pouvoir public, ni sur ses mandataires. D'où ceux qui devraient être représentants du peuple rendent compte non pas à ces derniers, mais à leurs autorités morales. Les représentants doivent rendre compte au peuple. La démocratie est réelle si le peuple contrôle la gestion de la res publica. Une telle conception permet le contrôle en série : les représentants contrôlent l'action du gouvernement et le peuple contrôle l'action de ses représentants.
3. L’enjeu de la culture démocratique en RD Congo
L’enjeu pour une culture démocratique en RD Congo se joue dans la capacité, que doit avoir le Congolais, de contrôler et d’exiger les comptes sur la manière dont ses représentants défendent ses intérêts. Ainsi, nous pensons que pour un retour à l’ordre démocratique en RD Congo, l’enjeu se situe dans le contrôle, l ‘évaluation, le jugement que le peuple doit opérer sur la gestion du chose publique. La situation en RD Congo montre que la démocratie est à venir. Et il urge de travailler à son avènement qui oblige un passage de l’anaxocratie à la démocratie. C’est-à-dire passer d’un système où tout l’appareillage politique travaille pour le maintien et les intérêts d’un individu, à celui qui cherche à accroître le bonheur de tous.
Ainsi, nous sommes persuadés qu'il y a nécessité de mettre les nouvelles générations congolaises à l'école de l'indocilité civique en vue d'un retour aux fondamentaux de la démocratie dont l'enjeu majeur se situe au niveau du contrôle des représentants. Un tel projet nous le situons au niveau d'une éducation à la subversion. Cette dernière est comprise comme d’une part, le désir et la détermination d’opter et d’œuvrer pour une nouvelle manière non conformiste de lire
et de comprendre le contrat social qui nous fonde comme peuple et comme nation. Et d'autre part, prendre le courage de retourner aux fondamentaux de la démocratie en se débarrassant, sans effusion de sang, d’un ordre socio-politique anaxocrate.
Conclusion
En somme, dans le contexte de la RDC où un groupe d’individu minorise la majorité, il nous parait illusoire de continuer à considérer la définition scolaire de la démocratie comme le seul horizon de sens. Ainsi, nous pensons que la situation socio-politique en RD Congo nécessite une autre compréhension de la démocratie. Notre réflexion a taché de proposer à nouveau frais l’approche de la démocratie. Nous avons compris cette dernière comme contrôle par le peuple : la capacité que doit avoir le peuple d’avoir une mainmise sur ses représentants et d’exiger les comptes à ces derniers. La question qui reste pendante est celle de savoir comment pouvons-nous organiser la cité de telle sorte que le peuple garde de manière permanente la mainmise sur ses représentants. Autrement-dit, de quelle manière devrions-nous travailler pour l'avènement d'une société congolaise où le peuple n'est pas dépossédé de son pouvoir ? Cette question fera objet de nos prochaines investigations.


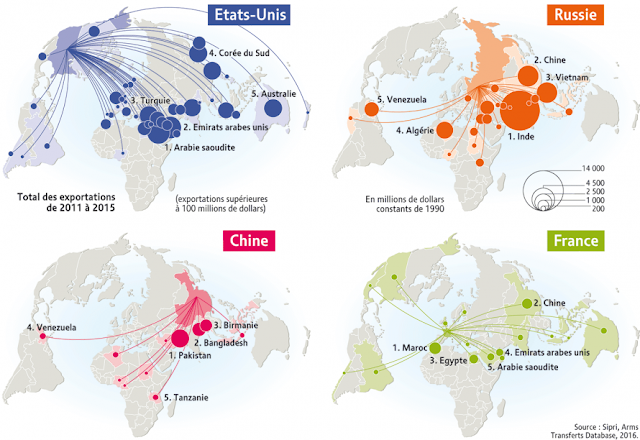
Bonne réflexion. Mais il me semble que celle-ci s'arrête en chemin, sans ébaucher les pistes du comment orchestrer ce contrôle par le peuple. À mon sens, il y a ici l'espace d'un autre débat non pas tant sur l'anaxocratie seulement, mais sur l'anomocratie en ce que celle-ci institue et promeut un pouvoir qui, in se per se, s'érige en norme en rusant, dans une spirale autopoeitique, avec le respect des normes librement consenties par tous (seule condition de possibilité de la démocratie). Un tel pouvoir, envers et contre la volonté du Tiers-Instituant qu'est le reste du corps social, en se faisant la norme, se sustente d'anomie et reste aux antipodes de la démocratie.
RépondreSupprimerMerci pour votre réaction cher Yantumbi
Supprimer1. Vous avez raison. Notre réflexion est en chemin. Comme toute réflexion scientifique, nous avons placé une virgule et ouvert ainsi d'autres perspectives de recherche comme notre "conclusion-introduction" l'insinue: comment pouvons-nous organiser la cité de telle sorte que le peuple garde de manière permanente la mainmise sur ses représentants?
2. Je pense que l'anomocratie à laquelle vous faite allusion est due au fait qu'en RD Congo et dans tant d'autres pays africains il y'a une sorte de me-compréhension de ce que vous avez appelé "volonté du tiers instituant"; que je puis nommer Contrat Social. La classe politique se trouve devant un peuple qui semble ne pas être concerné par le Contrat Social. Ainsi, elle interprète le Contre Social selon son entendement; pour ne pas dire en sa faveur. La "spirale autopoeitique" est, en mon sens, une conséquence.
3. Nous sommes ainsi en face d'un pouvoir politique qui cherche à maintenir le peuple dans cette me-compréhension du Contrat Social. C'est en ce sens que l'on peut saisir le pourquoi de l'hostilité de la plupart des gouvernants en Afrique contre tout mouvement d'éveil de conscience politique et civique. (Le sort que subit l'Eglise Catholique et les Mouvements Citoyens en RD Congo, au Cameroun, au Tchad et ailleurs peut vous en dire plus). Dans ce contexte, se re-approprier le contrat social est le premier des horizons de la démocratie en DR Congo. Le contrôle par le peuple est un des aspects de cette re-appropriation du Contrat Social.
J'ai lu cher C Mukadi, avec beaucoup d'intérêt votre reflexion et je souscris largement au flow des idées telles que élaborées. Ma préoccupation sur le sujet est que le mode de gestion d'un pays (d'un continent l'Afrique) qui garantirait le contrôle effectif du peuple sur ses richesses doit impérativement tenir compte de la dynamique extérieure que je voudrais résumer en l'influence des occidentaux prédateurs sur le peuple tout entier. Cette dynamique extérieure se mesure en fonction des rapports de forces sur le plan économique entre nous et eux.
RépondreSupprimerEn effet, pour se rendre la tâche, les occidentaux souhaitent que l'Afrique aie un systeme de gouvernance où l'interlocuteur lorsqu'il s'agit d'accès à nos richesses est manipulable pour quelques raisons que ce soit. La démocratie représentative à la mode actuellement s'offre comme mode de gestion favorable pour eux pour plusieurs raisons (faiblesses) parmi lesquelles:
1. L'élement de division du peuple via le concepte de multipartisme. La force du peuple est annihilée au travers ces divisions.
2. L'élement division ci haut-mentioné prédispose les acteurs politiques à la manipulation (les élections demandent des moyens financiers et ceux qui vous soutiennent pour les gagner vous contrôlent),
Il y a lieu de repenser la démoctatie comme mode de gestion non seulement en garantissant son fonctionement à l'interieur de l'entité mais aussi en jaugeant son efficacité face à la convoitise exterieure.
Merci
J'aimerais bien vous nommer par votre nom. hélas, je n'ai pas pu le faire parce que vous avez, apparement, fait le choix de l'anonymat. Qu'à cela ne tienne. Merci tout de même pour votre réaction pertinente.
SupprimerJe puis résumer votre intervention en un point : l'organisations interne ou externe d'un Etat est déterminée par le rapport des forces que ce dernier entretien avec d'autres Etats, spécialement ce que l'on nomme ''grandes puissances''. Ce qui n'est pas faux.
Dans la mesure où j'ai saisi ta pointe, j'ai deux considérations à proposer:
1. La "philosophie de victimisation" dans laquelle une certaine épistémologie essaie saisir la crise socio-politique des Etats en Afrique ne semble pas nous avancer.
Certes, plusieurs pays convoitent les ressources que regarde la RD Congo. Cependant, ces pays, puissants soient-ils, ne nous empêchent pas de faire du Congo un pays qui donne des raisons d'espérer à ses filles et fils. Par contre, nous leur facilitons la tâche de bien piller les ressources que nous avons.
2. Le rapport des forces entre Etats n'est pas une fatalité. Un Etat se construit autour d'un idéal commun de bien vivre ensemble; idéal qui s'exprimes dans la loi et s'incarne dans des instituions fortes. C'est l) un des jalons de la puissance d'un Etat. Des pays tels que le Ghana, la Tanzanie, etc. sont déjà dans cette perspective.
Bref, tout en prenant en considérations la réalité de rapport des forces entre Etats, travaillons plutôt dans le sens de construit un Etat qui donne des raisons d'Espérer.